Je suis un homme à gilet jaune
Je voudrais de l’eau chaude, s’il vous plait.
Il m’aborde dans un anglais parfait, avec une pointe d’accent qui roule les « r ». « Pouvez-vous m’en donner dans un grand récipient ? ». J’acquiesce avec le sourire. Je suis un homme à gilet jaune. L’un de ceux à qui l‘on adresse ce genre de requête et qui s’en occupe en souriant. Deux bras et un sourire, c’est tout ce que j’ai pour les gens d’ici. Mais c’est déjà beaucoup. Il m’a trouvé sur son chemin et m’a simplement demandé de l’eau chaude. Il me l’a demandé à moi, parce que je suis un homme à gilet jaune. Celui qui apporte une petite trace d’humanité dans un long périple inhumain. Lui c’est un réfugié, fuyant son lointain pays en guerre et débarqué le matin d’avant sur cette île de Grèce qu’on nomme Lesbos. Le soleil est déjà haut. Le camp est calme. Les hommes forment de petites grappes autour des braseros et les enfants jouent en riant. Je me dirige vers la tente du thé.
Hier c’était la nuit du nouvel an. Le camp était calme aussi. Il faisait froid, quelques flocons de neige étaient tombés dans la matinée, mais cela n’avait pas émerveillé ceux qui voyaient pour la première fois le ciel faire tomber ses cristaux blancs . Le vent soufflait, chacun s’était abrité sous sa tente, comme il pouvait. Ceux qui n’y étaient pas avaient pris un taxi pour Mytilène, pour célébrer la nouvelle année dans la chaleur réconfortante d’un des nombreux cafés de la ville. Au café ou sous la tente, chacun se pressait de trouver refuge, il n’y avait pas de raison de veiller tard au camp ce soir-là.
J’avais choisi le café. Avec mes amis volontaires, nous avions ôté nos gilets jaunes, et nous avons célébré ce nouvel an particulier en cognant joyeusement nos verres de mojito dans un bar où l’on danse jusque tard. La nuit avançait. Vers quatre heures, je voulus profiter de ma dernière journée sur l’ile aux réfugiés pour voir le soleil se lever sur la mer. Dans ma petite voiture rouge, je quittais la ville et roulais doucement en direction du sud. Il faisait encore nuit noire, il faisait froid, mais le ciel était clair. Le vent soufflait toujours. « La mer doit être formée, me disais-je, et je doute que les bateaux partent cette nuit ». Tant mieux. C’est mieux comme ça. On voudrait qu’il n’y en ait aucun qui traverse. On voudrait qu’il n’y en ait jamais eu. Mais ça ne finira jamais. Ils traverseront. Encore et encore. Quoiqu’il arrive. Quel que soit le froid, les risques, les lois, les murs, les frontières, les barbelés, les passeurs, quelles que soient les mises-en-garde, quel que soit le prix, les noyades. Les candidats à la traversée sont des millions. Des millions qui arriveront encore chaque jour sur deux boudins de caoutchouc au milieu d’une mer glaciale, par groupe de quarante ou soixante, sans bien savoir où ils atterrissent. Tant que cette mer, pourtant inhospitalière, sera plus sûre pour eux et leurs enfants que ce qu’ils fuient sur la terre ferme, ils viendront. Mais cette nuit il n’y en aura sans doute aucun, la mer est trop grosse et c’est mieux comme ça. J’étais passé le long de l’aéroport et continuais doucement sur la route presque rectiligne, avant de m’arrêter sur cette petite esplanade au-dessus du rivage, juste avant que la route ne remonte en serpentant puis oblique vers l’ouest. Les autocars du HCR étaient là, déjà, moteurs en route pour faire fonctionner le chauffage. La camionnette des boat rescuers hollandais aussi, comme chaque nuit. Derrière le pare-brise, un homme scrutait l’horizon avec ses jumelles, emmitouflé dans une veste chaude. A l’arrière, des jeunes dormaient, sans que l’on puisse distinguer, sous leurs épais bonnets, si c’étaient des garçons ou des filles. Quelques volontaires isolés, comme moi, avaient garé leur voiture au bord de la petite falaise.
Ce fut un lever de soleil magnifique. Le souvenir de sa clarté illumine encore mes pupilles. Le vent soufflait, froid et fort, mais le ciel n’avait pas été aussi clair depuis plusieurs jours. Ici, le soleil d’hiver se lève paresseusement. Comme si, lui aussi, avait du mal à émerger de sa bonne nuit de sommeil, et qu’il trainait un peu en rêvassant. Quand le soleil se lève tout doucement au-dessus de la mer Egée, le festival des lumières du matin est encore plus beau. Au commencement, la mer est encore noire, mais une lueur commence à se dessiner au-dessus d’une ligne irrégulière, dont on devine qu’il s’agit de la côte turque toute proche. Puis, lentement, un trait orange apparait, chassant aussitôt le noir de la nuit au-dessus des montagnes au loin, tandis qu’une étoile, mon étoile, brille encore fort au-dessus de ma tête. Il faut attendre de longues minutes encore pour que la clarté du jour apparaisse, pour qu’on puisse distinguer la mer de la côte. Mais ce temps qui s’écoule avec lenteur est un plaisir. Mon étoile est toujours là, elle brille fort. J’aime cette étoile qui m’accompagne partout où je vais, la dernière à s’éteindre. Le disque du soleil apparait d’abord pourpre, en s’élevant insensiblement derrière la montagne. La mer se teinte de bleu profond et le ciel l’imite, à moins que ce ne soit l’inverse. Un nuage se forme au-dessus du soleil et on dirait une soucoupe volante dans le générique d’un film de science-fiction hollywoodien. Le nuage s’étire, la boule du soleil grandit et jaunit, et on dirait maintenant qu’un grand oiseau plane sur ce paysage. Cela dure des heures et c’est beau. De temps à autres je sors de ma voiture pour immortaliser l’instant, respirer un bol d’air, et échanger trois mots avec ceux qui sont là, comme moi, les yeux à l’horizon, pleins de la beauté du matin. Je n’ai pas dormi et pourtant je n’ai pas sommeil. Je rentre vite ensuite dans la chaleur timide de ma petite voiture. Quand le soleil s’installe enfin, dans sa majesté, les couleurs de la journée se figent alors pour un long moment. Bientôt les bus HCR s’en vont un à un, signal qu’aucun bateau ne viendra probablement ce matin-là. Quelle heure est-il ? Huit heures ? Neuf heures ? Peu importe. Nous sommes en 2016, et rien ne presse. Le vent se calme peu à peu avec le jour. Mon bonnet fétiche rouge sur la tête, je sors rejoindre le groupe formé des volontaires adorateurs du Ra de Lesbos ce matin-là.
Lorsqu’un van de volontaires grecs débarque sur la petite place en déballant sur une table de pique-nique brinquebalante une profusion de galettes, brioches et gâteaux, la magie est complète. C’est le petit-déjeuner traditionnel du nouvel an, une coutume locale. Qu’il faut apprécier en avalant cul-sec des rasades d’une sorte d’ouzo bien alcoolisé et en claquant la langue. Je ne suis pas en reste. Je goute de tout. Je veux faire l’expérience totale. Puis, une grosse caméra s’approche et tout le monde s’agite. Un petit bonhomme un peu épais, les traits chinois et la barbe fournie, se joint au groupe. C’est Ai Weiwei. On l’a croisé à Moria toute la semaine, et moi qui savait à peine qui c’était jusqu’à la veille. Je me rattrape. Je l’aborde. Pas bavard le chinois. Mais je n’abandonne pas. Je selfise. En fait il selfise, parce que Ai Weiwei est très gentil, peu bavard, mais très gentil, et il selfise avec tous ceux qui lui demandent, mais on ne selfise pas avec Ai Weiwei. Ai Weiwei selfise avec toi dessus. Il cadre, sourit à peine et déclenche la machine. Merci Ai Weiwei. Quel succès !
Je reste encore un peu, là, au bord de l’eau. C’est ma dernière journée à Lesbos, et bien qu’ici une journée dure six mois, je sens que je n’en ai pas eu assez. Ai-je le droit de penser que j’aurais aimé rester bien plus longtemps ici ? Ai-je le droit de dire que j’ai passé des moments extraordinaires à Lesbos ? Ai-je le droit de dire que j’ai ri avec les réfugiés ? Ai-je le droit de dire que j’ai aimé mes amis volontaires ? Ai-je le droit de dire que je n’ai parfois pas aimé certaines attitudes de certains volontaires et de certains réfugiés ? Ai-je le droit de dire que dans ces moments de tension, j’aurai voulu mettre ma main à la figure de certains volontaires et de certains réfugiés ? Ai-je le droit de dire que certains réfugiés sont beaux, certaines réfugiées de belles femmes et tous les enfants attachants ? Ai-je le droit de dire que certains ont moins de grâce à mes yeux mais qu’ils m’ont tous paru attachants ? Ai-je le droit de dire que le contact était si facile et agréable avec tous ? Ai-je le droit de dire que j’ai élevé la voix contre certains ? Ai-je le droit de dire tous les moments où je voulais pleurer, crier, me révolter ? Quand on voit la mer, et ces bateaux arriver. Ai-je le droit de dire, qu’après l’arrivée à la côte, ce sont les sourires et les rires qui dominent parmi les réfugiés ? Ai-je le droit de dire que j’ai probablement croisé plus de semeurs de terreurs dans une rame de métro un matin à Paris que pendant toutes ces journées auprès de réfugiés d’Irak, d’Afghanistan et de Syrie ? Ai-je le droit de dire que ces papis et mamies débarqués au petit matin, qui n’ont pour tout souvenir qu’un petit sac plastique noir avec toute leur vie dedans, avec leurs canes, leurs fauteuils roulants et leurs grappes de petits-enfants, sont les êtres les plus digne et touchants que j’ai croisé récemment ? Ai-je le droit de dire que je ne me sens ni responsable, ni coupable de tout ce chaos, et que je vais continuer à boire mes bulles de champagne parce que ça n’y changera rien ? Ai-je le droit de dire que j’ai révisé ma géographie en croisant tant de volontaires et de réfugiés du monde entier, venus de plus de pays que je ne pourrai en visiter ma vie durant ? Ai-je le droit de dire que j’ai révisé mon histoire, ma philosophie, mes religions ? Ai-je le droit de dire que j’ai révisé la condition humaine ? « Ai-je le droit de dire que j’ai aimé venir à Lesbos ? » Ai-je le droit de dire que j’ai aimé venir à Lesbos ? Je crois que oui. Parce qu’on y reçoit plus que ce qu’on ne donne, parce qu’on y croise des dizaines d’anges, et autant d’histoires de vie.
Alors je reste encore un peu, là, au bord de l’eau. En pensant à tout cela. Et je regarde la mer. J’aime la mer. J’aime la mer sous toutes ses formes. J’aime toutes les mers. J’aime la mer quand elle est calme, j’aime la mer quand elle rugit, j’aime la mer quand elle est transparente, j’aime la mer grise, la Mer Noire, la Mer Morte, la Mer Rouge, j’aime la mer quand elle se blanchit d’écume, j’aime les grosses vagues, j’aime les vaguelettes, le ressac, j’aime le grand large, j’aime la côte, l’arrivée sur les îles, j’aime les îles, j’aime l’Atlantique, la Méditerranée, j’aime Tanger et puis Belle-Île, j’aime Mogador et Massilia, et j’aime la mer Egée. Mais je ne sais pas si je pourrai encore la regarder, sans un frisson sur l’échine, une larme au coin des yeux. Je ne sais pas si je pourrai encore aimer la mer Egée, après l’avoir vu ici, cracher, chaque jour, son lot de réfugiés. Alors je reste encore un peu au bord de l’eau, confus, à savourer cet instant de soleil et à regretter cette mer si triste. Puis, sans savoir trop pourquoi, je rentre soudainement dans ma petite voiture et fais route vers Moria.
Mais je ne sais pas si je pourrai encore la regarder, sans un frisson sur l’échine, une larme au coin des yeux. Je ne sais pas si je pourrai encore aimer la mer Egée, après l’avoir vu ici, cracher, chaque jour, son lot de réfugiés. Alors je reste encore un peu au bord de l’eau, confus, à savourer cet instant de soleil et à regretter cette mer si triste. Puis, sans savoir trop pourquoi, je rentre soudainement dans ma petite voiture et fais route vers Moria.
Je suis heureux de retrouver Moria ce matin-là. Heureux de retrouver mes amis de la veille déjà en action avec leurs gilets jaunes. J’embrasse ceux que je quitterai tout à l’heure. Sans arrivée de bateau dans la nuit et ce matin, le camp sera paisible aujourd’hui. Le soleil revient et c’est une bonne nouvelle. Il réchauffe le jour. C’est une belle journée qui se prépare. Je suis heureux d’être de retour à Moria, de me sentir utile avec mon gilet jaune, mes deux bras et mon sourire. Et je souris aux réfugiés qui descendent par petits groupes de la colline, leurs gros sacs sous les bras, je leur lance des « salam » à tout va. Ils sont contents de partir. Moi non. Ils voulaient écourter leur séjour à Moria, moi l’inverse. Ils sont heureux de quitter cet endroit. Moi triste. J’étais en vacances. Eux non. Je buvais des bières le soir au café avec mes amis. Eux non. J’étais au chaud la nuit dans un lit confortable. Eux non.
On me demande de l’eau chaude, alors j’entre en action. Je me dirige vers la tente du thé, là où, nuit et jours, des volontaires se relayent pour préparer du chaï brulant aux épices dans une énorme marmite sur une bonbonne de gaz. A tout moment, les réfugiés passent et reçoivent un gobelet de thé chaud au lait avec quelques biscuits. Comme une petite trace d’humanité dans un long périple inhumain. Il y a déjà de l’eau qui chauffe pour la marmite suivante, et je n’ai pas à attendre pour remplir un des grands thermos dont on se sert d’ordinaire pour les distributions aux files d’attente de l’enregistrement Frontex.
Je reviens donc assez rapidement en direction de l’homme qui demande, ce matin-là, de l’eau chaude, ma bonbonne à la main. Je suis un homme à gilet jaune, quand j’apporte de l’eau chaude, je souris et entame la discussion. Je suis un homme à gilet jaune, celui qui apporte une petite trace d’humanité dans un long périple inhumain. Alors je parle un peu à l’homme. Je lui demande : « alors, vous allez faire du thé pour toute la famille ? ». Il me regarde tristement. Il y a quelque chose qui cloche, visiblement. Après un temps il me répond, gentiment, dans son anglais qui roule les « r » : « non monsieur, ce n’est pas pour le thé, c’est pour la toilette du petit ». Il lit immédiatement mon regard interloqué, et mes yeux qui sans doute dessinent déjà un léger air de reproche. Tout se lit sur moi… Oui, peut-on faire ici la toilette des enfants à l’eau chaude, lorsque c’est une ressource trop rare ? L’eau de la tente du thé c’est pour boire chaud, pas pour laver la crasse des nombreux jours de voyage et le sel de la mer, ah non, désolé, je suis l’homme à gilet jaune, celui qui apporte un peu d’humanité dans ce long périple inhumain, mais il y a des règles, et ici tout le monde se lave à l’eau glacée du robinet, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, nourrissons, I am sorry, ana asef, je suis désolé, bebakhshid, sighnomi, c’est comme ça. Mais l’homme comprend mon regard et il devance mes paroles :
C’est pour le petit. La toilette du petit. Il est mort cette nuit.
Il ne pleure pas. Ne crie pas. Il parle doucement d’un air triste et las. Et il m’annonce que son fils de quelques mois est mort. Une émotion immense me remplit immédiatement. Ni larmes, ni mots, juste un tressaillement, un tremblement, un grand malaise et des yeux grands ouverts. Et c’est presque lui qui me console. Parce que l’homme à gilet jaune, celui qui apporte sourire et humanité dans un long périple inhumain, il n’est pas préparé à ça, pour lui les bébés ça ne dort pas dans le froid sous la tente, pour lui les bébés ça ne traverse pas la mer sur des rafiots en caoutchouc à peine gonflés, pour lui un bébé ça dort paisiblement dans son berceau au chaud à la maison. Pour l’homme à l’accent qui roule les « r » aussi. Ça l’était. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus quatre murs qui tiennent encore debout autour du berceau, jusqu’à ce que la fureur des bombes et des hommes le chasse de sa vie ordinaire, lui et le bébé, jusqu’à ce qu’il arrache son bébé à son berceau et sa douce chaleur, pour les routes sans fin, et que les minces toiles de tente lui tiennent lieu de murs pour se protéger de la pluie mais pas du froid. Il sait ce que je ressens et il est désolé pour moi. C’est ainsi. Les hommes à gilet jaune, ceux qui apportent un peu d’humanité, en reçoivent souvent plus des réfugiés qu’ils n’en donnent. Et ce monsieur avait beaucoup d’humanité à me donner ce matin-là. Il me raconte doucement son histoire, avec ses mots, simples, dans son anglais parfais qui roule un peu les « r ».
Cela fait longtemps qu’il a quitté la Syrie avec sa famille, trop longtemps. La route par la Turquie puis la traversée depuis les plages d’Izmir, la traversée traumatisante. Il est parti de Syrie avec quatre enfants. Il arrivera en Europe avec trois. Pourquoi ? Tout le monde était sur le même bateau. La traversée fut terrible. La mer agitée. Tout le monde était trempé. Les enfants. Le bébé. En débarquant, ils ont été pris en charge par des gentils volontaires à gilet jaune. Et la maman et le bébé par des médecins en blouse blanche. Le bébé était fatigué, mais il ne souffrait pas d’hypothermie, hamdoullah. Alors ils l’ont réchauffé doucement. La maman s’est réchauffée elle aussi. Et le bébé allait mieux. Puis bien. Il a pris le sein de sa mère et s’est endormi paisiblement, emmailloté dans d’épaisses couvertures. La famille, les quatre enfants, se sont installés sous la tente. Le soir est tombé. La soupe avalée, tout le monde est allé se coucher. Les hommes à gilet jaune veillaient sur cette famille. Ils leur ont apporté des couvertures. Tout le monde s’est couché, tout le monde s’est endormi sous une épaisse montagne de couvertures. C’était le soir du nouvel an. Un soir pour se coucher tôt pour cette famille, serrés les uns contre les autres sous la tente qui claquait de temps en temps sous les rafales de vent froid.
Les enfants s’endorment. Le bébé s’endort. La maman s’endort. Et le papa, rassuré, le bébé bien calé entre eux, s’endort aussi. La nuit passe. La nuit du nouvel an. La nouvelle année s’annonce par un ciel froid et clair. Et le soleil qui monte doucement. La lumière inonde la tente. Les enfants dorment encore. La maman s’éveille la première. Elle se tourne immédiatement vers son bébé. Elle a dormi si profondément. Et le bébé n’a pas pleuré cette nuit. La première fois depuis longtemps. Mais il a bougé, gigoté, son sommeil devait être agité. Oh ! et il s’est découvert. Vite les couvertures. Tu dors encore petit bébé ? Dors mon bébé, dors mon ange, reprends des forces. Le chemin est encore long. Pourquoi as-tu les yeux ouverts mon bébé ? Pourquoi ne sembles-tu pas respirer ? Que se passe-t-il mon bébé ? Tu as si froid. La maman passe sa main doucement sur son visage. Tu as si froid. Que se passe-t-il ? La maman réveille son mari. Mon homme il y a un problème avec notre bébé ! Mon homme viens à mon secours ! Mon homme, mon cœur de maman a peur de comprendre ce qu’il s’est passé. Mon homme, mon amour, mes bébés…mon homme….mon bébé…mes enfants….mon bébé, pourquoi n’as-tu pas crié, pourquoi n’as-tu pas appelé ta maman, pourquoi ? Pourquoi après tout ce chemin ? Mon bébé, mon cœur, ma chair, mon sang, pourquoi ? Reviens à la vie ? Ne me laisse pas !… Ne laisse pas ta maman, ton papa et tes frères ! Et ta sœur chérie ! Mon homme réveille-le ! Mon homme pourquoi pleures-tu ? Mon homme, c’est notre bébé, réveille-le, réchauffe-le ! Mon homme, pourquoi l’emmènes-tu avec toi ? Mon homme que se passe-t-il ? Pourquoi mon bébé est mort ? Est-il mort de froid par cette nuit de nouvel an, après cette longue route et cette traversée ? Allah, Allah, pourquoi ? Allah ! je ne suis plus rien à cet instant…
Alors l’homme va laver le corps à l’eau chaude, il va faire la toilette mortuaire ou rituelle, je ne sais pas. Et il ira enterrer le petit corps. Ici.
Sur une terre qui n’a pas grand sens pour sa famille. Ce n’est pas la terre de son cœur, celle de son pays pourtant chéri qu’ils ont dû quitter malgré eux. Ni celle qu’ils se seront plus ou moins choisi pour démarrer une nouvelle existence, juste faite de la vie tranquille de tous les jours. Et ce bébé n’a même pas eu le droit à quelques mois d’une vie heureuse. Et, ce papa, cette maman, et leur terrible culpabilité sans doute le matin au réveil, leur tristesse qui restera une blessure toute leur vie. Et ce bébé qui après tout ça, n’ira jamais dans ces jardins d’enfants en Allemagne dont sa maman devait rêver pour lui cette nuit-là.
Et la famille de quatre enfants continuera demain son chemin à trois enfants. Et le papa me dit que c’est le destin, et moi je n’arrive pas à l’accepter. Parce que ce n’était pas cela le destin de ce petit enfant. Je n’y crois pas. Je ne peux croire que Dieu, Allah ou quelque puissance divine ait décidé cela pour ce petit bébé. Et je ne peux croire qu’on se console que les trois autres soient encore en vie, et donc Dieu merci. Pardonnez ma révolte naïve, pardonnez-mes propos s’ils choquent une culture ou une vision de vie, mais je crois que la destinée de cet enfant c’était de grandir homme, de devenir médecin, garagiste, nageur professionnel ou une sorte de Mandela ou de Kofi Annan. Alors, à moins que cette histoire et celles de tous ceux qui, ensemble, témoigneront de cette nuit-là à Lesbos, à moins que cette histoire et toutes les autres ne soit reprisent des milliers de fois, ne soit comprises par des millions de gens à travers le monde, à moins que les gens simples du monde entier ne se lèvent ensemble tout d’un coup pour agir et faire en sorte qu’il n’y ai plus un seul enfant, quelle que soit son origine ou sa situation, qui meure de froid sous une tente sur notre belle terre d’Europe, à moins que tout ceci ne se passe, alors sa mort n’aura servi à rien. Si tout cela survient, alors son destin aura eu un sens. Mais, mes amis, je n’ai pas cet espoir. Aylan et la photo de son cadavre échoué sur une plage turque ont fait le tour du monde. Et depuis, il y a des dizaines d’Aylan tous les jours. Et ce bébé n’est qu’un autre Aylan, anonyme, parmi d’autres. Il me touche parce que j’ai vécu son histoire. Il vous touche parce que je vous la raconte. Et puis vous l’oublierez. C’est bien normal. Moi sans doute jamais. Et je crains que sa mort n’ait servi à rien. A rien.
L’homme me raconte, mais mon esprit imagine, et c’est terrible. Sur le coup ce n’est qu’une grande émotion, et puis je suis l’homme à gilet jaune. Celui qui sourit et qui agit. Pas celui qui pleure sur les vies perdues. Alors j’écoute son histoire et je le regarde s’éloigner à pas lent, le thermos d’eau chaude à la main. Cette histoire me pénètre au plus profond, sans que je puisse m’en rendre compte à cet instant. Car bien vite je suis happé par une nouvelle histoire. D’autres réfugiés arrivent. D’autres réfugiés à réconforter, orienter, vêtir, nourrir. D’autres volontaires à qui parler, à saluer. La vie de l’homme à gilet jaune ne connait pas de répit dans le camp de Moria. Le répit consiste à s’arracher de force, souvent longtemps après l’horaire de son engagement, épuisé, nerveux, lorsque tout sourire a quitté son visage, pour filer prendre une douche chaude et s’envoyer quelques verres en rigolant avec les copains et copines à gilet jaunes, en évoquant les histoires les plus extraordinaires de la journée.
Ce jour-là est mon dernier jour. Et c’est le jour de l’an. Quand, dans ma petite voiture rouge, je fais demi-tour sur la route qui redescend vers le port, quand je m’apprête à quitter les lieux, quand je parcours les premiers mètres qui m’éloignent de Moria, je croise le regard triste et fatigué mais sans colère d’un homme qui attend, stoïque, sur le bord de la route. Qu’attend-il ? Je croise son regard et la profondeur de ses yeux me touche. Je ne sais pas dire pourquoi. Peut-être parce que ce regard, c’est celui de l’homme venu de Syrie qui a perdu son bébé mort de froid ce matin ? La main du Ciel a-t-elle voulu me faire un signe ? C’est cet homme le dernier dont je croiserai le regard en quittant Moria. Comme si il avait voulu, lui aussi, me faire signe. Me laisser un message. Me dire, va. Sois le messager, raconte mon histoire. Va, va dire au monde ce qu’il se passe ici. « Va, va dire au monde ce qu’il se passe ici. » Va dire au monde que sur vos plages d’Europe, celles sur lesquelles vous passez vos vacances d’été, un cocktail à la main, sur vos belles plages d’Europe, vous laissez nos bébés mourir de froid, après une longue et inhumaine traversée. Va dire au monde que les portes fermées, c’est admettre la mort d’enfants innocents, et qu’il faut désormais se préparer à la violence de la révolte qui en résulte.
Oui, ici, à Lesbos, et sur toute la route des réfugiés en Europe, on laisse les bébés mourir de froid, sous des tentes de fortune la nuit de nouvel an par moins cinq degrés. Ce bébé a échappé aux bombes et aux balles en Syrie. Il a survécu à la traversée de l’Egée dans un pneumatique de fortune, submergé par les vagues d’une eau glaciale. Pour venir mourir de froid sur cette belle terre grecque une nuit de nouvel an. Comment dire « happy new year » après ça ? Happy quoi ?
Je n’ai même pas pensé à m’arrêter saluer l’homme. J’ai pleuré. Pleuré mon pays. Le peuple de France. Qui ne comprend pas. J’ai pleuré le monde, son ignorance et mon impuissance. Puis quand toutes mes larmes eurent coulées, quand elles furent séchées, réconforté par la chaleur de mes proches et des anges de Lesbos, j’ai pris mon rôle de messager à bras-le-corps, pour dire au monde et à voix haute la vie perdue de ce petit bébé.
La photo du cimetière des enfants réfugiés à Lesbos est de: Amrit Singh (@MrASingh) NowHumanity.com
Si vous souhaitez vous porter volontaire à Lesvos ou diriger vos dons directement à l’aide aux réfugiés à Lesvos, vous pouvez vous adresser à Better Days For Moria
Et suivre leur page sur facebook: Better Days For Moria
sur ce sujet, vous aimerez lire aussi: A quoi penses-tu ? et Je m’appelle Xié
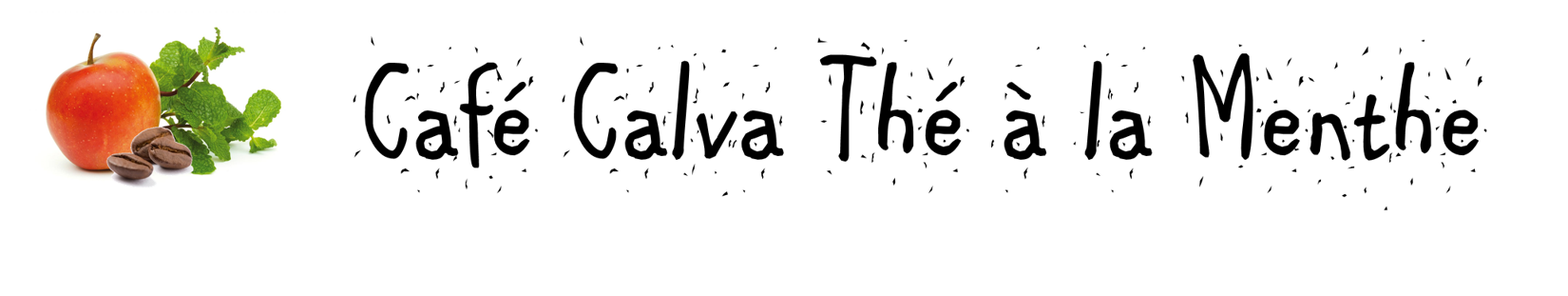





















































je trouve votre blog tres interessant 🙂
merci beaucoup 🙂