Je m’appelle Xié
Je m’appelle 鞋 . Je ne suis pas bien vieille, je ne suis encore qu’une enfant. Et pourtant j’ai déjà une longue histoire. Je m’appelle 鞋 . Il faut prononcer « Xié » en accentuant le « é ». C’est important. Je ne suis encore qu’une enfant et je suis toute mignonne. C’est un nom très courant en Chine, Xié, pour une petite fille comme moi, vous savez. Je suis née en Chine. J’ai une sœur jumelle. Oui, oui. Une vraie jumelle. On est vraiment pareilles elle et moi, sauf que ma marque de naissance je l’ai à droite, et elle à gauche. Moi, je ne voulais pas grandir. Vieillir pourquoi pas, un peu, parce qu’il y a plein de choses qu’on m’interdit de faire et que j’aimerais faire. Comme aller dans les flaques de pluie. M’enfoncer dans le sable d’une plage et prendre un bain d’eau de mer. Mais pas n’importe où. Une belle plage à la mer chaude. Il y avait une image comme ça, dans la maison où j’habitais, encadrée sur un mur. Une plage avec du sable très jaune et une mer transparente. Comme j’aimerais y aller ! Avec ma jumelle bien sûr. Avec ma jumelle on fait tout pareil. Toujours l’une à la suite de l’autre. N’essayez pas de nous séparer ! Comme on dit, « on fait la paire », et l’une sans l’autre on est rien, perdues. On ne se quitte pas d’une semelle, pour ainsi dire, et tout ce que fait l’une, l’autre l’imite aussitôt après.
Je ne suis ni très grande ni très vieille mais j’ai déjà beaucoup voyagé. Si, si. En bateau. C’était mon premier voyage. Dans un grand bateau qui a quitté la Chine dans la nuit avec plein d’autres familles comme nous. On partait pour un pays lointain. Bon, c’était juste après ma naissance donc je ne me souviens pas bien. Mais sur les photos en papier brillant on me voit bien. A moins que ce ne soit ma jumelle.
J’étais avec mes parents. Mais on a été vite séparés. C’est ainsi. C’est souvent le cas à un moment de notre enfance pour les gens de notre origine et de notre condition, vous savez. En arrivant dans ce pays inconnu, on a d’abord été transportés dans un grand camion. Et puis entassés dans un hangar mal éclairé, plein de poussière et qui sentait l’humidité. On a eu de la chance on y est pas restés longtemps. Mais c’est là qu’on a été séparées de nos parents, avec ma sœur. On était bien trop jeunes pour comprendre ce qu’il se passait. Si j’avais su, on se serait tous accrochés les uns aux autres. Mais un gros monsieur aux mains sales est arrivé, il était en sueur parce qu’il faisait chaud et qu’il avait l’air de travailler dur. Il a ouvert la porte de l’endroit dans lequel on était tous serrés dans l’attente de l’inconnu, et il nous a emmenées, ma sœur et moi, avec quelques autres.
Les rumeurs les plus folles circulaient là-bas. Qu’on allait être exploitées. Qu’on allait être vendues. Aux quatre coins de ce pays inconnu dans lequel on avait débarqué. Vendues sur les marchés, carrément. Alors quoi ? Les gens passeraient et si on leur plaisait, ils discuteraient avec le gros monsieur et hop ? Adoptées par une nouvelle famille ? Personne ne voulait y croire. Ça semblait trop gros. Certes le voyage puis nos conditions de vies n’étaient pas idéales, on respirait mal. Il faisait très chaud dans la journée et la nuit venue, on grelotait de froid, ma sœur et moi, collées l’une contre l’autre. Mais au moins on était tous ensemble. Semblables. Et ensemble.
Les rumeurs sont parfois fondées. Celle-ci l’était. Ma sœur et moi, nous avons été emmenées, en plein cœur de cette ville dont on apprendrait à dire le nom plus tard. Damascus. Ça sonne bien pourtant. C’est dans un pays que les gens appellent la Syrie. Un beau pays, vraiment. Ça peut sembler invraisemblable mais oui, en plein cœur de la ville on a été vendues, par ce gros monsieur, à une nouvelle famille. Le père nous trouvait si jolies toutes les deux. Si petites et mignonnes. Encore un peu bébé. Faut dire qu’ensemble, on est craquantes. Alors il voulait faire plaisir à sa fillette, il nous a prises par la main et il nous a posées sur la banquette arrière de sa voiture. On était assises au milieu de plein d’autres choses qu’il avait achetées. On a roulé longtemps. Jusqu’à une petite ville où on est arrivés à la nuit tombante. En arrivant à la maison il y avait un air de fête. En nous découvrant toutes les deux, la fillette eut un sourire si grand, que toute notre tristesse s’envola. Nous vécûmes dans cette famille les moments les plus heureux de notre vie.
Ce n’était pas une vie extraordinaire, oh non. Mais une jolie petite vie. La fillette nous emmenait partout avec elle. Bon, lorsque sa maman l’autorisait seulement, mais comme elle nous adorait, c’était presque tous les jours. Chaque matin on partait à l’école tous ensembles. Ce n’était pas loin du tout l’école, mais la maman nous accompagnait quand même pour être sûre qu’on traverse bien la grande avenue sur laquelle les voitures passaient à toute allure. Même si le plus souvent, c’était plutôt cacophonie et embouteillages, les voitures sur l’avenue. A l’école on la suivait partout, dans la classe, dans la cour de récréation. Il faisait beau le plus souvent et on passait une grande partie de nos journées dehors à jouer en sautillant. Et on s’était même fait des copines au bout d’un moment. A la maison on était bien, même si l’endroit où l’on nous mettait le soir pour dormir était noir et exigu. Mais on s’y était habituées bien vite avec ma jumelle. La fillette grandissait vite, on savait qu’il faudrait qu’elle nous laisse un jour, qu’elle ne pourrait pas toujours nous garder avec elle. Mais elle avait une petite sœur qui mourait d’envie de lui ravir ses meilleures compagnes. Alors on était rassurées, ma sœur et moi, sûres d’avoir tout le temps quelqu’un pour s’occuper de nous.
Au fil du temps, le papa de la fillette semblait de plus en plus préoccupé. Oh pas à cause de nous. Il ne faisait plus guère attention à nous à vrai dire. Non, il discutait longuement avec la maman, et parfois d’autres personnes, dans la cuisine, des voisins je crois ou bien de la famille. Un matin, personne ne vint nous chercher. Pourtant c’était un jour d’école. On comprit un peu plus tard que la fillette n’irait plus à l’école. L’école avait fermé. Plus personne n’allait à l’école. Pour l’instant avait-on dit. En attendant. Mais en attendant quoi ? Alors tout le monde restait à la maison et on s’ennuyait un peu. On regardait des dessins animés à la télé. Mais nous, ce qu’on voulait par-dessus tout, c’était sortir, aller jouer au parc, se promener. Mais c’était trop dangereux. C’est ce que le papa disait et la maman acquiesçait. Un matin, on est sorties accompagner la maman qui faisait quelques courses et on n’a pas reconnu la ville. L’avenue habituellement bondée de voitures était presque déserte. Les rues étaient vides, les gens marchaient d’un pas pressé et beaucoup de magasins avaient fermé. Les rues de ce pays sont d’ordinaire tellement animées. Plus d’odeur de sucre chaud qui s’échappe des pâtisseries. Plus de charrettes pleines de montagnes de fruits, qui se faufilent dans les ruelles qui vont vers le grand souk. Plus les interpellations des boutiquiers sur le pas de leurs échoppes, qui invitent les passants à entrer. Disparus. Le papa quittait la maison plus souvent à présent, pendant plusieurs jours. Mais nous, on restait là. C’était une vie bizarre. Triste. On aurait dit que tout le monde attendait quelque chose, dans l’angoisse. On ne riait plus guère à la maison.
Un soir il y eut un grand bruit au loin. Des explosions. La fillette et sa sœur se sont réfugiées dans le lit de la maman. C’était un soir où le papa n’était pas là. Nous, on était bien sages, à notre place habituelle. Les bruits se sont approchés. C’était fort. Ça ne s’arrêtait jamais. C’était un peu comme l’orage, mais ça n’était pas un orage. On avait peur de l’orage lorsqu’il grondait dans le ciel. Mais ça n’était pas l’orage, non. C’était différent. La maison était silencieuse. Mais au dehors c’était terrible. Les murs tremblaient de plus en plus fort et les fenêtres vibraient. On entendait parfois quelques cris dehors, entre deux explosions. Et ça s’approchait, de plus en plus fort. A travers les rideaux tirés, le ciel s’illuminait régulièrement d’une grande clarté jaunâtre. Au bout d’un temps interminable le bruit s’éloigna peu à peu. Puis cessa complétement. C’est alors un silence de mort qui s’installa. Les rues de cette ville ne sont jamais totalement silencieuses, même au milieu de la nuit. Mais cette nuit-là on n’entendait plus le moindre murmure. Et c’était inquiétant. On entendit alors, venu de l’appartement voisin, une longue plainte. Les cris d’une femme, inintelligibles, entrecoupés de sanglots. La maman se leva, enfila une djellaba et sorti sur le palier. Bientôt rejointe par d’autres voisins. Des voix d’hommes, des cris de femmes, des pleurs d’enfants inquiets, résonnaient à présent dans tout l’immeuble. On ne pouvait comprendre ce qu’il se passait, mais on savait que c’était anormal et sans doute terrible. Personne ne put vraiment dormir cette nuit-là. Je m’en souviens bien. Le lendemain, c’est la maman qui vint nous réveiller et nous faire signe de nous lever. La fillette avait un petit sac à dos dans lequel elle mettait habituellement tous ses trésors d’enfant lorsqu’on partait pour la journée. La maman avait, elle, une grosse valise à roulette noire qu’elle tirait derrière elle. Tout le monde était habillé chaudement, comme pour affronter une rude journée de froid, alors qu’un grand soleil brillait et qu’il faisait doux malgré l’hiver. On est sortis ensemble et on se mit à marcher dans les rues qui se remplissaient peu à peu. On ne partait manifestement pas pour l’école. Mais où allait-on alors ? Personne ne disait mot. Les gens dehors croisaient leurs regards, tristes, de la peur et de la compassion dans les yeux. Quand on eut fait trois cent mètres environ sur la grande avenue et tourné à gauche, tout le monde s’arrêta devant le spectacle qui s’offrait à nous. Tout le quartier était détruit. En ruine. On pouvait à peine reconnaitre l’endroit où était notre école. C’était une odeur de poussière. Et le silence, toujours, entrecoupés de temps à autres des cris d’hommes qui fouillaient à la force de leurs bras les vastes décombres. Au coin, une femme était écroulée sur elle-même, en pleurs. Personne ne semblait se soucier d’elle. Alors c’était ça les explosions hier soir ? Alors c’était ça la guerre ? Oh, bien sûr on avait entendu ce mot, chuchoté par le papa ou la maman dans la cuisine pour ne pas qu’on l’entende. Mais pour nous, cela ne voulait pas dire grand-chose. Puisque c’était une chose de grandes personnes, pourquoi s’en soucier ? Nous on ne comprenait pas. Pourquoi tout d’un coup quelqu’un avait décidé de casser tout ce quartier ? Et les gens qui y habitaient ? Et les amies de la fillette ? Et nos copines de récré ? On leur avait dit de sortir avant ? Elles sont où maintenant ? C’est pour cela que la dame elle pleure ? Elle n’a plus de maison maintenant ? Et l’école ? On va aller où maintenant ? C’est ça la guerre ? Mais à quoi ça sert de casser tout ça ? Ils ont rien fait les gens qui étaient là !
Les bombes étaient tombées sur la ville. Pas sur nous, mais sur les immeubles d’à côté. On a fait demi-tour et on est rentrés à la maison. On n’en est pas sorties pendant plusieurs jours. Il n’y avait presque plus rien à manger. Puis le papa est rentré. Et on est partis. Pour de bon.
On en a fait des kilomètres en marchant. On est bien nées, ma jumelle et moi, on est résistantes. Mais la fillette et sa petite sœur étaient épuisées. Parfois on trouvait un grand taxi qui nous emmenait un peu plus loin. Mais ils ne voulaient jamais nous garder bien longtemps. Parce qu’il y avait des barrages et des contrôles partout sur les routes. Des soldats armés, qui faisaient peur et qui ne souriaient jamais. Il fallait à chaque fois parler longuement et montrer tout un tas de papiers que le papa gardait toujours sur lui, pour qu’ils nous laissent passer. Mais il fallait toujours descendre de voiture. Ils ne laissaient jamais passer les voitures. Alors on marchait encore, jusqu’à ce qu’on puisse trouver à nouveau quelqu’un qui veuille bien nous prendre dans sa voiture.
On dormait là où on pouvait. Quand le soir venait, le papa se préoccupait de chercher une chambre pour nous tous, dans le village où on se trouvait à ce moment-là. Parfois c’était un petit hôtel, le plus souvent une chambre dans une maison ou un appartement qu’un habitant voulait bien nous louer. Là, on mangeait ce que la maman arrivait à nous trouver. Le reste du temps c’était du pain, des olives, parfois un fruit. Tout le monde avait faim. On pleurait souvent. On ne comprenait pas grand-chose. On croisait tant de gens comme nous, des dizaines de familles qui marchaient de ville en ville avec une petite valise et des enfants épuisés.
A un moment on est arrivés en vue d’un immense campement. C’était au pied d’une colline. Je me souviens, il pleuvait, une petite pluie froide qui transperce tout et vous glace pour longtemps. Le papa s’est éclipsé un instant pendant qu’on attendait assises au bord de la route, sans penser à rien. On ne se parlait presque plus depuis qu’on était partis. On dormait, on mangeait quand c’était possible et on marchait surtout. On était usées. Mais encore en forme malgré tout. Je vous l’ai dit, ma jumelle et moi on est résistantes.
Après une heure ou deux, le papa est venu nous chercher souriant. A quand remontait son dernier sourire ? Un sourire franc et entier. Un vrai sourire de papa, plein de tendresse pour ses enfants. Il vint nous chercher en souriant et nous installa sous une petite tente tous ensemble. Et il nous parla. La voix un peu tremblante d’émotion, mais souriant. Il nous dit que nous avions quitté la Syrie. Que c’était la guerre maintenant chez nous et que c’était trop dangereux pour nous tous de rester là- bas. Il nous dit qu’on était maintenant en sécurité. Qu’on était en Turquie. Et que la Turquie c’était la paix. Ce serait notre nouveau chez nous, la Turquie. Il avait dit : en attendant. En attendant que la guerre soit finie et qu’on puisse rentrer chez nous. Mais la guerre c’est quoi ? La guerre ça finit quand ? A quoi ça sert la guerre ? Le papa essaya d’expliquer. Que c’était comme quand la fillette et sa jeune sœur se disputaient pour un jouet ou bien à cause de nous. Mais il s’arrêta au milieu d’une phrase et ne poursuivit pas. Le silence s’installa à nouveau entre nous. Il se leva pour sortir, embrassa tout le monde en disant qu’on n’allait pas rester ici trop longtemps, qu’il le promettait, qu’il allait nous trouver une nouvelle maison et que bientôt il aurait un nouveau travail et nous, une nouvelle école.
Mais on est restés longtemps sous cette tente dans ce camp. Nous, on n’aimait pas rester ici. Mais on essayait de ne pas trop le dire. Parce qu’on voyait bien que la maman était triste et que le papa petit à petit perdait son sourire des premiers jours. On est restés combien de temps dans ce camp ? Deux mois ? Un an ? Comment savoir ? Quand on est enfant, on ne sait pas ces choses-là. On mangeait toujours la même chose. De la soupe ou de la bouillie. Le matin il y avait du lait chaud et du pain. Quand il ne pleuvait pas, on sortait jouer dehors. Il y avait des dizaines d’autres enfants de tous âges. Mais pas d’école. Nous, on aimait bien l’école. Ça nous manquait. Mais on ne disait rien parce qu’on voyait bien que la maman était triste et que le papa avait perdu son sourire. Parce qu’on voyait bien que la maison leur manquait autant qu’à nous et qu’ils auraient préféré continuer à nous accompagner à l’école chaque matin comme avant. Parce qu’on voyait bien que à cause de « la guerre », notre nouvelle maison c’était cette tente humide et froide, et que on allait sans doute y rester un moment. Le papa ne parlait plus d’en partir. Il ne disait plus grand-chose. Le matin il sortait, les dents serrées et ne revenait qu’au soir, en grommelant des trucs incompréhensibles, les mains chargées de ce qu’il avait pu trouver. De la nourriture le plus souvent, parfois un petit jouet que les fillettes prenaient sans grande joie. Il faisait si froid la nuit, que la fillette ne nous quittait jamais et on se blottissait tous ensemble sous une montagne de couvertures grises qui grattaient.
Nous, on rêvait de notre vie d’avant. On voulait revenir. On ne voulait plus de cette « guerre ». C’est nul la guerre. Ça sert à rien. La maman, souvent, le soir, elle allait au centre du camp, dans une espèce de bicoque où il y avait une télé, et tous ces gens de Syrie qui s’y entassaient. Nous, au début, on voulait y aller avec elle. Mais bien vite on n’a plus voulu. Tout le monde parlait fort en commentant les images qui nous semblaient toujours les mêmes. Des images de guerre, de villes détruites, de soldats en armes. Des images pas intéressantes. Des images nulles. Alors on restait sous la tente, et quand il n’y avait plus que les deux fillettes, on s’inventait toutes sortes de jeux sous les couvertures. Et on riait quand même.
Un matin il fallut repartir. Peut-être que le papa l’avait expliqué aux fillettes, mais nous, ça nous avait échappé. Il fallut repartir et marcher encore, comme lorsqu’on était parti de Syrie. Je ne sais pas si ça allait être mieux après, mais finalement on était plutôt contentes. Il n’y avait rien dans ce camp. Rien à faire pour nous. Pas d’école. Pas de jeux. Pas de manège ou de toboggan. Même pas de dessins animés. Que de la boue et de la saleté qu’on n’arrivait même plus à faire partir tellement elle collait. Assez vite heureusement on est tous monté dans un grand autocar avec plein d’autres familles venues de Syrie, comme nous. Et on a roulé. Ça a duré une journée et une nuit. On s’ennuyait, mais au moins on était bien installées. L’autocar s’arrêtait tout le temps, même si personne ne descendait. Tout le monde avait l’air d’aller au même endroit. Nous, on ne savait pas trop. Mais on avait appris à ne pas poser trop de questions. Il y a des moments où les enfants savent qu’il ne faut pas poser de questions aux grandes personnes. Où ils savent que leurs questions d’enfants ennuient les grandes personnes. Peut-être parce qu’elles ne savent pas y répondre, les grandes personnes. Comme par exemple « à quoi ça sert la guerre ? ». Les grandes personnes sont nulles parfois. La guerre ça sert à rien et puis c’est tout. C’est pourtant simple.
On est arrivé lorsqu’il faisait encore nuit. On a compris qu’on était arrivées parce que tout le monde est descendu, sans bousculade, en emportant les maigres bagages qu’ils avaient avec eux. Là, de petits groupes se sont formés. Et l’autocar est vite reparti. C’était sur une sorte d’esplanade, au bord de la route. On ne voyait aucune maison alentour. Des hommes qui n’avaient pas l’air gentils et qui parlaient une langue qu’on ne comprenait pas, passaient de groupe en groupe. C’est le papa qui parlait pour nous. On s’était regroupés avec trois autres familles de Syrie qui étaient un peu comme nous. On ne venait pas de la même ville, mais au camp on avait fait ami-ami. Pendant que les papas parlaient avec ces jeunes hommes bizarres, les mamans attendaient en silence. Et nous, on jouait doucement avec quelques cailloux au bord de la route. Le papa nous fit signe. On se remit en route, en suivant l’un des hommes pas gentil qui portait une casquette rouge à l’envers, qui avait une barbe même pas belle et qui sentait mauvais. Il téléphonait tout le temps en criant. Après avoir marché le long de la route quelques instants, il nous arrêta et nous demanda de l’attendre là. Il revint pas très longtemps après, au volant d’une grosse voiture, suivie par deux autres. Il nous emmena, nous et les autres familles de notre groupe dans un appartement pas bien loin de là, où il y avait deux chambres et une petite cuisine. Franchement, c’était petit et pas très confortable, mais après les tentes du camp, personne ne se plaignit. Tous les enfants passèrent à la douche immédiatement. Tout fut lavé à grande eau et au savon. Nous aussi. Et ça faisait du bien parce que ça faisait longtemps qu’on s’était pas lavés et changés et qu’on se grattait de partout. Et ça faisait comme un premier grand moment de repos et de calme depuis des jours. Tout le monde s’endormit bien vite, la plupart d’entre nous par terre sur les carreaux, sous les couvertures que l’on avait emportées avec nous.
Ici, il ne faisait pas aussi froid qu’au camp. On était tout au bord de la mer, on pouvait la voir par la fenêtre de la chambre. C’était beau. On aimait bien regarder par la fenêtre. Même si le ciel était couvert et que le vent soufflait, c’était beau de voir la mer. Nous, on pensait que si on allait rester là, que si c’était ça notre nouvelle maison, c’était pas si mal. Même si on était vraiment entassés dans ces deux pièces, même si certains devaient dormir dans la cuisine ou la salle de bain, on trouvait que c’était mieux ici qu’au camp ou que n’importe où ailleurs, mieux que tout ce qu’on avait connu depuis qu’on avait quitté la maison.
Mais un soir tout le monde s’agita. Tout le monde avait l’air content. Inquiet mais content. Il fallut ranger tout le désordre, plier les couvertures, faire entrer tout ce qu’on avait amassé dans des grands sacs poubelles noirs. Mais tout ne rentrait pas. C’est qu’on avait ramassé pas mal de bricoles à force. La fillette avait, elle, son petit sac à dos. Elle était sage et ne garda avec elle que ses petits trésors de la maison. De toute façon, les autres jouets, elle ne les aimait pas. Ils lui rappelaient le camp et c’était que des mauvais souvenirs. Ses souvenirs à elle c’était sa maison en Syrie, et elle ne voulait garder que ceux-là. Le reste, elle préférait l’oublier. Tout était rangé. Ce qu’on ne pouvait pas emporter était empilé dans un coin. Un grand tas fait de couvertures et d’objets de toutes sortes. On attendait. Ce fut long. Au milieu de la nuit, on frappa à la porte et le méchant monsieur entra dans l’appartement sans sourire. Il parlait toujours dans son téléphone en criant. Tout le monde se leva. Il regarda chacun d’entre nous en faisant des signes bizarres de la tête. Il ne nous aimait pas. Et moi je l’aimais pas non plus. Après il fallut sortir. C’était la nuit et il faisait froid. Mais le vent s’était tu et le ciel était clair. On faisait quoi maintenant ? Pourquoi quitter cet endroit encore ? La guerre va-t-elle aussi arriver jusqu’ici ? Ce n’est donc jamais fini !? Il faut fuir encore, marcher, attendre ? C’est quand notre nouvelle maison ? Notre nouvelle école ? C’est pas la Turquie notre nouvelle maison ? On marcha en groupe, en direction de la mer, bientôt rejoints par d’autres groupes. Je ne sais pas combien de familles il y avait, mais peut être dix, peut-être plus, qui se retrouvaient là tout d’un coup au milieu de la nuit au bord de l’eau. Au loin sur la mer on voyait des lumières briller. Il y avait quoi là-bas ? Des bateaux ? Une voiture comme celle qui était venue nous chercher à l’autocar se stationna et le méchant monsieur tira du coffre un paquet de gros gilets orange. Il y avait des grands pour les grandes personnes et des petits pour les enfants. Un instant après, tout le monde avait enfilé son gilet orange. On entendit un moteur qui se mettait en marche. Et on nous poussa vers le bord de l’eau. Là, je compris tout de suite. Il fallait tous monter dans un petit bateau. Et nos gros gilets orange c’était pour partir en bateau. Mais il faisait froid et c’était la nuit. Moi, je ne voulais pas partir dans ce bateau. On nous fit monter un à un. Les femmes, les enfants, puis les hommes. On s’asseyait comme on pouvait. Sur les bords en caoutchouc ou bien au fond. Mais c’était mouillé. Et il faisait froid. Et les enfants commençaient à pleurer. Et les hommes disaient au méchant monsieur des choses pas gentilles. Mais le méchant monsieur, il n’avait pas l’air de s’en soucier. Nous, on était déjà mouillées. Parce qu’il fallait mettre les pieds dans l’eau pour monter sur le bateau. Et on avait froid aussi. On allait où sur ce petit bateau ? C’était un tout petit bateau gonflable, un peu comme ceux avec lesquels les enfants jouent à la plage, mais en plus grand quand même. En temps normal, on aurait été tout excitées à l’idée de faire un tour sur un engin comme ça. Mais on n’était pas en temps normal. Tout le monde n’arrivait pas à monter à bord. On était bien trop nombreux pour ce petit bateau. Ils n’avaient qu’à en trouver un deuxième ! Mais il n’y avait pas de deuxième bateau. Il y avait celui–ci et rien d’autre alentour. Rien que le méchant monsieur qui agitait sa lampe torche en criant et en nous éblouissant, et la voiture un peu plus loin qui n’avait pas éteint son moteur. Alors le méchant homme demanda à tout le monde de jeter son sac pour que tout le monde puisse monter. Mais personne ne voulait se séparer de ses affaires. C’est normal, non ? Alors le méchant monsieur a hurlé des mots dans notre langue avec un drôle d’accent, en sortant un gros revolver de sa ceinture. Moi, je n’en avais jamais vu auparavant. Et tout le monde a eu peur. Et tout le monde a jeté son sac, les femmes pleuraient et les hommes criaient, mais tout le monde a jeté son sac, et toutes les familles sont finalement montées. Et le petit moteur à l’arrière s’est mis à vrombir et le bateau est parti. On était les uns sur les autres. La fillette avait gardé son petit sac à dos. Elle ne pleurait plus. Elle est courageuse vous savez. Elle tenait sa petite sœur par la main et nous, on était là aussi. Au début ça allait. Tout le monde s’est calmé et on avançait doucement vers les lumières au loin. Mais au bout d’un temps, le bateau bougeait et roulait, et la mer froide rentrait, et tout le monde était mouillé, et les enfants assis au fond étaient assis dans l’eau. Et on claquait des dents.
Le moteur s’est arrêté. Mais on n’était pas arrivés. On n’était nulle part. Il faisait encore nuit et on était au milieu de la mer. Les hommes se sont agités. Une femme s’est mise à paniquer et à crier dans tous les sens, et Allah par-ci et Allah par-là. Nous, on voulait qu’elle se taise. Et le bateau bougeait encore plus. Et la mer rentrait encore plus. Et on était maintenant tous vraiment trempés, des pieds à la tête. Et on avait froid. Plus que froid. On se recroquevillait les uns contre les autres sans bouger. Le moteur reprit enfin son ronronnement. Les hommes se calmaient. Combien de temps cela allait-il durer ? On avançait doucement, en direction des lumières. Le jour se levait peu à peu. Au moment où tout le monde s’était agité, au moment de la panne, le sac à dos de la fillette lui avait échappé. Il flottait entre deux eaux au fond du bateau. Et je vis ma sœur. Elle aussi. Ma jumelle. Elle avait aussi échappée à la fillette. Elle était là, dans l’eau, au fond du bateau, tout à côté du sac à dos, sans dire un mot. Et moi hébétée de froid, qui ne pouvait rien faire pour elle, qui m’accrochait de toutes mes forces à la fillette. J’aurais voulu hurler, dire à la maman de faire attention à ma jumelle chérie, de la rattraper, de la rendre à la fillette, de l’accrocher quelque part. Mais j’étais muette. Et immobile. Le jour s’est levé complétement. On distinguait à présent une côte toute proche. Les lumières qu’on voyait au loin étaient celles d’une ville sans doute. Je compris qu’on allait là. Qu’on se rapprochait. Qu’à moins de couler tous dans cette mer sombre et glacée, nous allions débarquer là-bas. Mais on n’y était pas encore. On devrait rester là encore combien de temps ? Plus personne ne pouvait bouger. Le moteur faisait des bruits irréguliers, parfois il fumait tant, que tout le monde toussait en respirant la fumée. Mais il marchait encore et poussait doucement notre petite embarcation vers les lumières de la côte.
Ce fut une vague plus grosse que les autres qui emmena ma sœur jumelle adorée. Un vague qui remplit le bateau presque entièrement. Tout le monde alors, les hommes et les femmes, se sont mis à écoper comme ils pouvaient. Avec leurs mains ou leurs chaussures. Et dans cette agitation, une main étrangère l’a attrapée, elle et tout ce qui flottait au fond du bateau, et l’a jetée à la mer comme un vulgaire lest dont on se sépare. S’en est-elle rendu compte ? Ou bien avait-elle déjà perdu connaissance ? Le soleil était déjà haut maintenant. La côte était toute proche. Celle qu’on devait atteindre. On distinguait des voitures sur la route. Déjà les hommes commençaient à se réjouir. Mais ma jumelle, qui s’en préoccupait ? A-t-elle coulé rapidement au fond ? Flotte-t-elle encore entre deux eaux ? S’est-elle échouée sur une plage turque, quelqu’un ramassera-t-il son cadavre ?
Moi, je suis arrivée avec la fillette, parce qu’on s’est bien accrochées l’une à l’autre. J’étais trempée jusqu’aux os, mon corps disloqué, et j’avais perdu toute mes couleurs. Je tremblais de froid. Le bateau pneumatique est arrivé doucement sur cette plage. Et tout le monde a sauté du bateau. On nous a emmenées au bord toutes les deux, et recouvertes d’une espèce de grande feuilles dorée qui faisait comme une couverture. C’était joli quand j’y repense. Mais sur le coup je pensais à autre chose. Je pensais que j’avais tellement froid que j’allais mourir. C’est alors que j’ai été arrachée à la fillette, brusquement et sans ménagement, par un grand gars barbu aux cheveux blonds qui parlait encore une langue que je ne comprenais pas. Tout le monde avait l’air content qu’il soit là, moi aussi d’ailleurs, parce qu’il était gentil, qu’il nous parlait et nous souriait et qu’il s’occupait de nous. Mais il m’a séparée de la fillette et m’a laissée là, sur la plage, seule, abandonnée. Sans espoir de retrouver ma famille d’adoption. Ni aucune autre d’ailleurs. Qui voudrait de moi à présent ? Sans ma jumelle et dans mon état ?
Je me rappelle mon histoire. Je m’appelle Xié et je suis née en Chine. Avant de rendre l’âme seule et abandonnée sur cette plage de Lesvos, je voulais la raconter. Je m’appelle Xié, je ne suis ni grande ni vieille, et je rêvais d’une vie longue et heureuse. Mais ma jumelle s’est noyée en mer et moi je vais finir ma vie là, seule, abandonnée du monde, abandonnée de tous.
Je m’appelle Xié.
Mon nom en chinois veut dire « chaussure ».
Je suis – j’étais – une jolie petite chaussure d’enfant.
Petite Xié je t’ai rencontrée ce matin-là sur la plage. Je marchais, seul, profitant du soleil et de la mer, perdu dans mes pensées après avoir accueilli mon premier bateau de réfugiés, un peu plus tôt. Je m’étais arrêté et je ne t’ai pas vue tout de suite. Je regardais
 cette épave échouée sur la plage, sur laquelle les vagues venaient mourir à un rythme régulier, un peu triste, et toi tu étais là, tout près. Xiézi, tu m’as appelé de ta petite voix, tu m’as dit « viens, approche ! », et moi je ne savais trop que faire. Ce n’est pas courant d’entendre parler une petite chaussure, tu sais… Tu m’as dit « approche, s’il te plait ». Alors je me suis approché, un peu intimidé. Je n’osais pas te toucher. Tu m’as dit que j’avais l’air d’un homme bon et que tu voulais me raconter ton histoire. Et moi je t’ai dit ma phrase favorite « oh, je ne suis pas un héros », tu as souri et de ta petite voix d’enfant, ignorant ma gêne, tu m’as raconté. Tu m’as dit que tu étais heureuse de pouvoir me raconter ton histoire. Tu m’as dit que c’était important pour toi. Moi, je voulais te ramasser, te ramener auprès de la fillette, mais tu m’as demandé de ne pas le faire. Tu m’as dit que, sans ta jumelle, tu ne valais plus rien, et que tu préférais rester un peu, là, au soleil. Que tu n’avais plus froid. Et que je ne devais pas m’inquiéter. Tu étais si raisonnable, comme parfois savent l’être les enfants quand ils parlent aux grandes personnes. Tu ne m’as posé qu’une seule question. Si je savais à quoi ça servait la guerre. Et moi je n’ai pas su te répondre. Peut-être parce que je suis une grande personne. Ou bien peut-être parce que je n’en sais rien, au fond. Alors tu m’as dit que toi, tu savais, et qu’il fallait que les grandes personnes le sachent aussi. Tu m’as dit de ta toute petite voix d’enfant, bien assurée, que toi, tu savais. Que c’était simple. Que la guerre ça servait à rien et puis c’est tout. Tu m’as dit de ne pas être triste. Tu m’as dit « tu sais je ne suis
cette épave échouée sur la plage, sur laquelle les vagues venaient mourir à un rythme régulier, un peu triste, et toi tu étais là, tout près. Xiézi, tu m’as appelé de ta petite voix, tu m’as dit « viens, approche ! », et moi je ne savais trop que faire. Ce n’est pas courant d’entendre parler une petite chaussure, tu sais… Tu m’as dit « approche, s’il te plait ». Alors je me suis approché, un peu intimidé. Je n’osais pas te toucher. Tu m’as dit que j’avais l’air d’un homme bon et que tu voulais me raconter ton histoire. Et moi je t’ai dit ma phrase favorite « oh, je ne suis pas un héros », tu as souri et de ta petite voix d’enfant, ignorant ma gêne, tu m’as raconté. Tu m’as dit que tu étais heureuse de pouvoir me raconter ton histoire. Tu m’as dit que c’était important pour toi. Moi, je voulais te ramasser, te ramener auprès de la fillette, mais tu m’as demandé de ne pas le faire. Tu m’as dit que, sans ta jumelle, tu ne valais plus rien, et que tu préférais rester un peu, là, au soleil. Que tu n’avais plus froid. Et que je ne devais pas m’inquiéter. Tu étais si raisonnable, comme parfois savent l’être les enfants quand ils parlent aux grandes personnes. Tu ne m’as posé qu’une seule question. Si je savais à quoi ça servait la guerre. Et moi je n’ai pas su te répondre. Peut-être parce que je suis une grande personne. Ou bien peut-être parce que je n’en sais rien, au fond. Alors tu m’as dit que toi, tu savais, et qu’il fallait que les grandes personnes le sachent aussi. Tu m’as dit de ta toute petite voix d’enfant, bien assurée, que toi, tu savais. Que c’était simple. Que la guerre ça servait à rien et puis c’est tout. Tu m’as dit de ne pas être triste. Tu m’as dit « tu sais je ne suis  qu’une petite chaussure. Notre vie à nous c’est comme ça, elle ne dure guère et on finit toujours comme ça, d’une façon ou d’une autre. » Tu m’as dit que tu préférais rester là. Qu’il valait mieux que je m’en aille à présent. Tu m’as dit, petite Xiézi, de ta voix d’enfant bien assurée, qu’il ne fallait pas que je sois triste, parce que l’essentiel c’est que la fillette, sa petite sœur et ses parents soient sains et saufs, qu’ils auraient à présent une nouvelle vie, oh peut-être pas comme celle d’avant, en Syrie, mais qu’elle serait heureuse tout de même. Que la petite fille et tous ceux qui étaient sur le bateau ce matin-là étaient heureux d’être arrivés ici, et qu’il fallait que je sois heureux pour eux et que dans tout cela le sort d’une petite chaussure importe peu. Petite Xiézi, tu es sage et belle.
qu’une petite chaussure. Notre vie à nous c’est comme ça, elle ne dure guère et on finit toujours comme ça, d’une façon ou d’une autre. » Tu m’as dit que tu préférais rester là. Qu’il valait mieux que je m’en aille à présent. Tu m’as dit, petite Xiézi, de ta voix d’enfant bien assurée, qu’il ne fallait pas que je sois triste, parce que l’essentiel c’est que la fillette, sa petite sœur et ses parents soient sains et saufs, qu’ils auraient à présent une nouvelle vie, oh peut-être pas comme celle d’avant, en Syrie, mais qu’elle serait heureuse tout de même. Que la petite fille et tous ceux qui étaient sur le bateau ce matin-là étaient heureux d’être arrivés ici, et qu’il fallait que je sois heureux pour eux et que dans tout cela le sort d’une petite chaussure importe peu. Petite Xiézi, tu es sage et belle.
Les chaussures sur l’île de Lesvos en Grèce
Quand les réfugiés débarquent par milliers à Lesvos chaque jour, fuyant les guerres de Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan, fuyant les camps invivables de Turquie ou d’ailleurs, lorsque les réfugiés débarquent dans l’hiver, transis de froid, choqués, mouillés, les vêtements et en particulier les chaussures sont une préoccupation importante. Il faut rester sec et chaudement vêtu pour ne pas risquer l’hypothermie ou de tomber malade, quand les températures la nuit avoisinent le zéro degré. Quelques flocons de neige tombent parfois, mais le plus souvent c’est la pluie, et dans les camps boueux et insalubres dans lesquels les réfugiés sont contraints de séjourner de longues journées, c’est une gageure que d’arriver à garder les pieds propres, secs et chauds. Il faut aussi avoir de bonnes chaussures pour continuer un trajet qui comporte souvent de grandes étapes à pied. Les volontaires de Lesvos reçoivent des dons, le plus souvent de particuliers, qui arrivent dans les valises ou dans les coffres des voitures. Ils achètent aussi quand ils le peuvent des vêtements aux commerçants de l’ile. Ils trient ensuite les chaussures par taille et les distribuent aux réfugiés qui arrivent, sur la plage ou dans les camps. Il n’y a malheureusement, la plupart du temps, pas assez de chaussures pour tout le monde.
Si vous souhaitez vous porter volontaire à Lesvos ou diriger vos dons directement à l’aide aux réfugiés à Lesvos, vous pouvez vous adresser à Better Days For Moria
Et suivre leur page sur facebook: Better Days For Moria
sur ce sujet, vous aimerez lire aussi: A quoi penses-tu ?
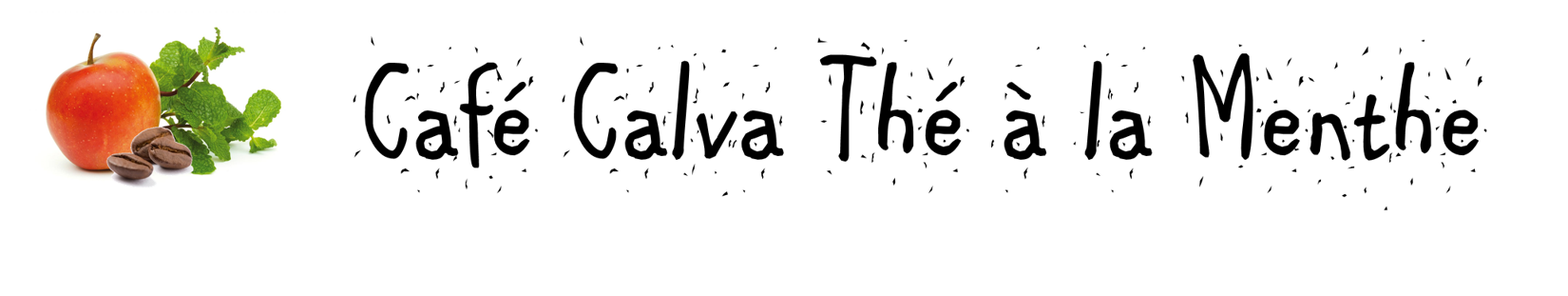
































3 réponses
[…] novel was translated with great heart and art from French original Je m’appelle Xié by Chloé […]
[…] sur ce sujet, vous aimerez lire aussi: A quoi penses-tu ? et Je m’appelle Xié […]
[…] You might also want to read: My name is Xié […]